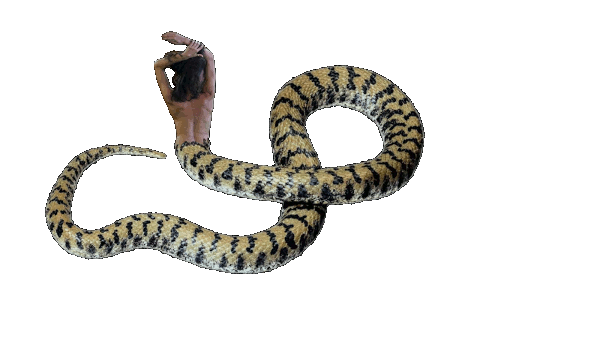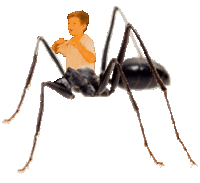

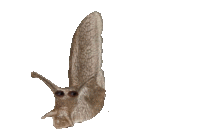
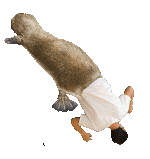
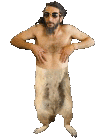

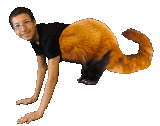

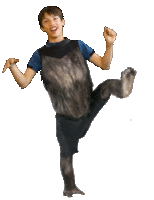
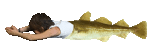

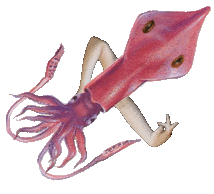

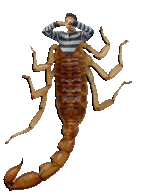
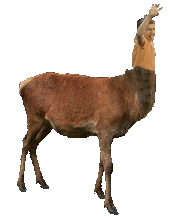


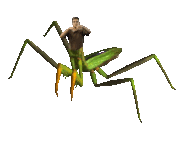
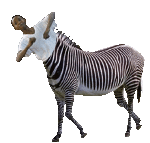
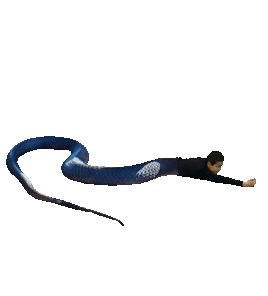

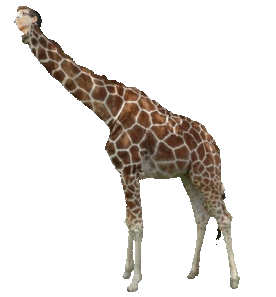


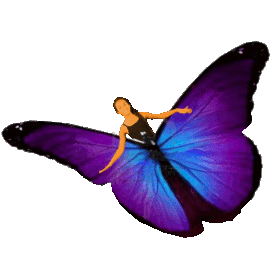
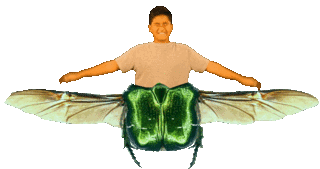


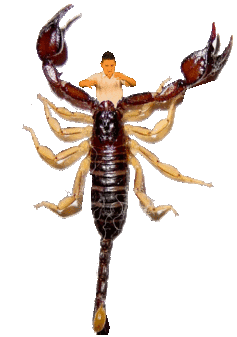
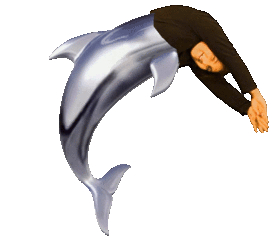


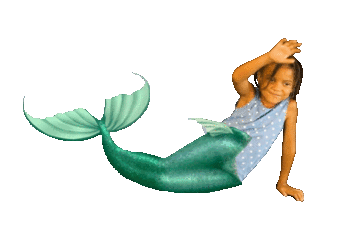
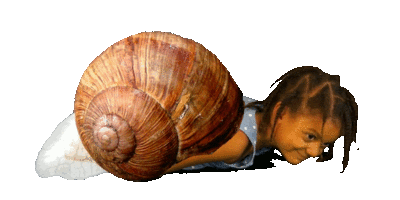



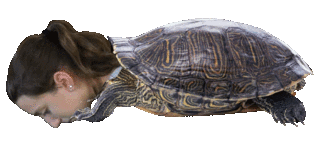



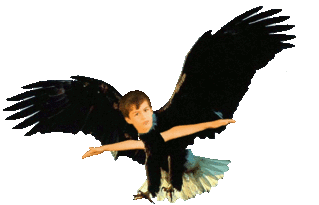
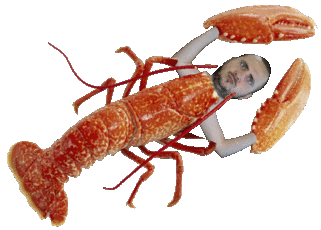
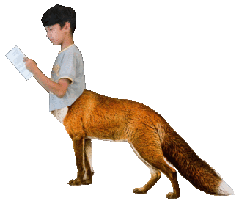

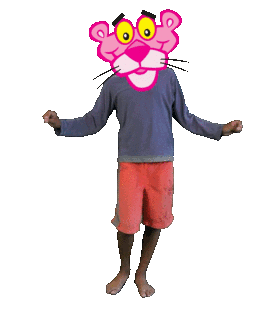




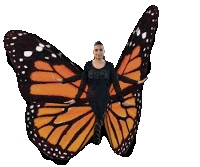
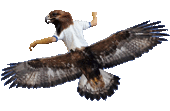

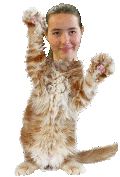

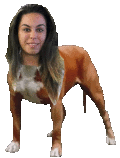







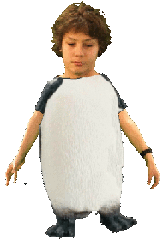
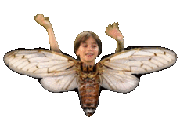






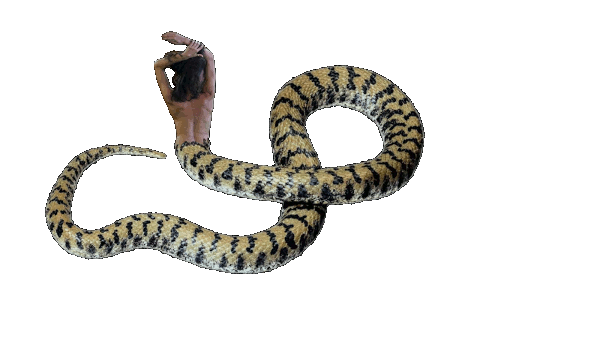

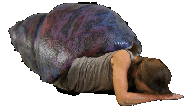
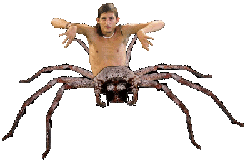



Qu'est-ce qu'une pratique ludique et vivante des T.I.C.E.s[2], ou pour mieux dire, une pratique créatrice de formes de vie et d’action? Qu'est-ce qu'une pratique esthétique de l'Internet ? Peut-on délimiter des protocoles, un peu comme des modes d’emploi, qui s’efforceraient de montrer, fût-ce de manière didactique, quels sont les contours et les bords d’une poïétique[3], d’un usage artistique, de l’Internet ?
L’œuvre d’art originale et ses copies potentielles se situent-elles sur un même plan de réalité ? Jusqu’où peut-on parler de la reproductibilité d’une œuvre d’art ? Quand peut-on parler d'objet authentique ? Quelles sont les frontières entre création et falsification? Et enfin quelles sont les conditions d'un art numérique ? La pratique des nouvelles technologies, et l'émergence du virtuel, ont comme enrichi les différentes strates de la réalité. Le réel se doublait déjà, depuis toujours, des puissances de l'imaginaire, mais il se double maintenant du miroir des mondes virtuels. La question à laquelle doivent être conduits les spectateurs est celle de la singularité essentielle du processus créateur, de l'hypothétique reproductibilité de ce processus, et de l'écart entre l'original et ses simulacres. Mais si la logique de la dissémination à l’œuvre dans la pièce d'Olaf Breuning[0], interroge la dialectique post-moderne du local et du global, du sujet et de la tribu, elle ouvre aussi un espace de liberté, un lieu pour se perdre et pour se retrouver, un "chemin qui ne mène nulle part" si ce n’est peut-être à soi.
S’il s'agit d'interroger le statut du spectateur, demandons-nous : Qu'est-ce qu'un sujet ? Qu'est-ce qu'un sujet esthétique ? Qu'est-ce qu'une subjectivité traversée par le flux des nouvelles technologies : Une subjectivité substantielle ? Ou bien transitionnelle, toujours en mouvement, en translation ? Le geste de réactualisation d'un objet artistique doit conduire les jeunes, individuellement et collectivement, à réfléchir sur l’usage qu'ils font des nouvelles technologies, et donc sur la constitution de leur subjectivité propre, en tant qu'elle est créatrice de formes, de rythmes et de ruptures. Il n’y a jamais que des corps et des langages, des langages à montrer, des corps à décoder. La subjectivité interrogée est un peu comme celle qui allume et qui éteint l'ordinateur, autrement dit une subjectivité itinérante, toujours en transit, qui remet en question la stabilité substantielle d'un moi identique à lui-même. La production esthétique de la subjectivité passe par des flux d'informations, autrement dit par des vitesses et des intensités – un peu comme ces gamers qui font l’épreuve d’eux-mêmes sur le mode d’une auto-affection hyperbolique et toujours discontinue.
Quelle est la signification de ce travail de réécriture ? Il part du postulat que parmi les paroles et les discours sans nombre prononcés par les hommes, raisonnables ou poétiques, logiques ou irrationnels, un sens s'est construit qui nous surplombe. Il n'y a donc de compréhension du sens d’un texte que par son inscription intertextuelle, par la participation de ce texte à un réseau global d’autres textes, qui le dépasse et le constitue. Ce qui vaut pour le texte vaut aussi pour l'image - qu'on apprend à décoder, à lire, à interpréter, et enfin à inventer. Nous retrouvons là la dimension réticulaire et contextuelle de toute signification (texte, image), en tant qu'elle fait sens au milieu d'un réseau, d'un système de signes, par un jeu de différentiation interne. Malgré cet axiome de base, - "dans une langue, il n'y a que des différences" - nous pouvons cependant lier ensemble les concepts de réécriture, de culture et d'hypertertextualité, mais aussi ceux de sujet, de langage, de corps et de communauté. Je propose ainsi au participant de réfléchir sur la manière dont il fabrique du sens, à l'intérieur d'un ensemble culturel donné. Il existe en effet des règles esthétiques de compréhension d’une œuvre d'art, des codifications qui structurent la réactualisation des archives passées. Le protocole que nous proposons, entre le jeu de réflexion et le jeu de rôles, entre game and playing, doit conduire le participant à réfléchir sur ce qu'est le sens, en le produisant lui-même.
« Habiter le monde en poète … » affirmait déjà le poète Hölderlin. La production esthétique de la subjectivité, dans son rapport aux nouvelles technologies, constitue un défi poïétique, où chacun est appelé à construire sa propre fiction sensible en réinterprétant le réel. Or les demeures de la pensée sont aussi les « aîtres du langage », de la médiation symbolique. C’est en passant par l’expression artistique, par la matérialité des signifiants, et la différenciation des signes qu’une habitation poétique du monde est possible. La pièce trouve ainsi son nœud et son dénouement dans une approche didactique du processus créateur et du processus de subjectivation à l'ère des nouvelles technologies.
Qu’est-ce qu’un sujet esthétique? Si ce n’est un passage, toujours incertain, entre l’ici et l’ailleurs - abîme ou béance, qui appelle l’ouvert d’un monde à exister.
Texte de Xavier Dubourdieu et Yann Mangourny, Nice le 1er octobre 2015.
[0] We are just animals, collage, 2005, Olaf Breuning. [1] Grec, sensation [2] Technologies de l'Information de la Communicaion et de l'Éducation [3] La poïétique a pour objet "l'étude des potentialités inscrites dans une situation donnée qui débouche sur une création nouvelle." (source : définition web, wikipédia.)Bibliographie.
- Karl-Otto Apel, Le logos propre au langage humain. L'éclat, collection Tiré à part, 1994.
- Alain Badiou, Logiques des mondes, Seuil, Paris 2006.
- Michel de Certeau, La Fable Mystique, 1. XVIé XVIIé siècle. chapitre 2. Le jardin, délires et délices de Jérôme Bosch. Gallimard.
- Claire Bardainne et Vincenzo Susca, Récréations, Galaxies de l'imaginaire postmoderne préface de Michel Maffesoli, CNRS éditions, Paris 2009.
- Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, dernière version 1939, in « Œuvres III », Paris, Gallimard, 2000
- Françoise Dastur, Hölderlin le retournement natal, Encre Marine, Paris 1997.
- Éliane Escoubas, Penser l’art et la folie avec Henri Maldiney. De la création : cycle raison folie déraison ![]() , Université de Lille 1.
- Michel Foucault, La naissance de la clinique, Paris 1963, PUF.
- Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, Gallimard, coll. « Tel », 1988
- Jean-Francois Lyotard, Le post-modernisme, Minuit, collection critique.
- Henri Maldiney, Regard Parole Espace, Paris, Cerf, 2012
- Henri Maldiney, Existence et création, Encre marine
- Michel Picard, La lecture comme jeu, Essai sur la littérature, (1986), Paris, Minuit.
- Platon, Phèdre, GF
- Michel Ribon, Esthétique de l'effacement. Essai sur l'art et l'effacement. L'Harmattan.
- Clément Rosset, Le réel et son double, Paris, PUF
- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, La lecture comme jeu – essai sur la littérature, Éditions de Minuit (coll. « Critique »), 1986
- Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Gallimard.
, Université de Lille 1.
- Michel Foucault, La naissance de la clinique, Paris 1963, PUF.
- Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, Gallimard, coll. « Tel », 1988
- Jean-Francois Lyotard, Le post-modernisme, Minuit, collection critique.
- Henri Maldiney, Regard Parole Espace, Paris, Cerf, 2012
- Henri Maldiney, Existence et création, Encre marine
- Michel Picard, La lecture comme jeu, Essai sur la littérature, (1986), Paris, Minuit.
- Platon, Phèdre, GF
- Michel Ribon, Esthétique de l'effacement. Essai sur l'art et l'effacement. L'Harmattan.
- Clément Rosset, Le réel et son double, Paris, PUF
- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, La lecture comme jeu – essai sur la littérature, Éditions de Minuit (coll. « Critique »), 1986
- Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Gallimard.
Ressources.
- We are just animals, collage, 2005, Olaf Breuning. - Le jardin des délices, 1503 - 1504, Jérôme Bosch. - 40 dessins en marge du Buffon, Pablo Picasso. - Green porno, Courts métrages, durée 2:50, 2008, Isabella Rosselini, arteTV. - Still alive, pigeon with blakberries, video, 0:43, 2005, Christian Gonzenbach, France. - Paris is Bourgeois, video, durée 1:34, 2010, Pascal Lièvre, France. - Lena, art video, 11:56, 2010, Magyarosi Eva, Hongrie. - Gets physical, 8:44, dans l’atelier de Daniel Gordon, 2013, New York, Etats Unis. - Misfits, taxidermie, Thomas Grunfeld, 2006, Allemagne. - Kaputt, Maurizio Cattelan, 2013. - Lise, milky way, video, Adel Abdessemed, France. - Dream unicorn, 2008, Damien Hirst. - Licorne, vidéo 7 minutes, 2007, Maider Fortuné. - Le Deuil, Transfert sur papier ancien rehaussé de crayon de couleur et de fard, cadre 42,7 x 52,2 cm, 2011, Jean-Luc Verna. - Innate Disposition, digital print plastic cutout displays, Katja Novitskova, 2012. - Bête et sauvage, Théo Mercier, 2010. Vues d’exposition Musée de la chasse, Paris Mars Mai 2010. (photo : Marc Dommage.) - Armée de terre, tout le monde dehors ! Julien Salaud, 2012. Galerie Suzanne Tarasieve / LOFT 19, Paris. (vues d’exposition © Rebecca Fanuele). - Accidents de chasse, Pascal Bernier, 1994-2000. - Ironie du sort, Antonio Gagliardi. - Le cheval, dessins, Adrien Vermont. - Les tuileries, 2011, Transfert sur papier ancien rehaussé de crayon de couleur, 36,5 x 46,2 cm, Jean-Luc Verna. - Coathangers, David Mach. - Hybrides, 2014, Liu Xue. - Garden, 2010, Acrlyc on canvas, 8×8 feet. Courtesy of Mountain Fold Gallery, Korakrit Arunanondchai.
WE ARE GIF ANIMALS, propose aux jeunes des quartiers Est de Nice de se réapproprier la pièce d'Olaf Breuning We are just animals pour en proposer une version interactive visible sur un site web et en réalité augmentée dans l'espace public le 1 Juin 2016 place Garibaldi à Nice.
WE ARE GIF ANIMALS, est une co-production LE HUBLOT dans le cadre du parcours urbain en réalité augmentée ART MOBILIS et bénéficie du soutien du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse, Ministère de la Jeunesse, de la Région PACA, de la CAF Alpes Maritimes et de la Fondation BNP Paribas.